La DEP est basée sur l’analyse du cycle de vie du produit – elle-même réalisée à partir de l’inventaire des flux de matières associés à la production, l’utilisation et l’élimination du produit – et les répercussions de ces matières sur l’environnement. Ces répercussions sont traduites par des indicateurs environnementaux, comme le potentiel de réchauffement climatique, mais aussi l’eutrophisation, l’acidification des eaux, l’épuisement des ressources, la formation de smog, l’appauvrissement de la couche d’ozone… Comme le potentiel de réchauffement climatique dérive des émissions de GES liées au cycle de vie du produit, il peut servir d’indice pour choisir un matériau bas carbone, mais un indice à prendre avec des pincettes et à relativiser, car toutes les DEP ne se valent pas.
Il existe en effet deux types de DEP : les spécifiques et les génériques. Les DEP spécifiques sont, comme leur nom l’indique, spécifiques d’un produit précis alors que les DEP génériques caractérisent des produits similaires provenant de plusieurs manufacturiers. Si les DEP s’appuient en théorie sur des ACV, le cycle de vie considéré est variable et, bien souvent, seule la phase de fabrication est prise en compte, négligeant les phases d’utilisation, d’élimination et de valorisation en fin de vie. Même si les DEP suivent des règles normalisées, il en existe plusieurs, et elles évoluent au fil des années. Pour toutes ces raisons, les DEP sont difficilement comparables et n’autorisent guère une comparaison directe des produits. Enfin, la DEP est davantage un gage de transparence de la part du manufacturier qu’un gage de faible empreinte carbone.
Au fil de quelques DEP
Comme l’a démontré l’initiative du Fonds immobilier de solidarité FTQ, le béton est un gros contributeur de l’empreinte carbone des bâtiments. Une stratégie pour réduire l’empreinte du carbone intrinsèque consistait à choisir un béton bas carbone composé de ciment contenant des laitiers. L’Association béton Québec a fait réaliser des DEP génériques représentatives des bétons produits par ses membres. Ces DEP sont établies sur la phase de la fabrication pour 1 m³ de béton et les émissions de GES varient de 200 à 500 kg éq. CO2 d’après la résistance en compression (20 à 80 MPa) et la composition du mélange (calcaire, cendres volantes, laitiers…). Si l’empreinte carbone du béton est aussi élevée, c’est à cause du ciment.
Au Rendez-vous des écomatériaux 2024, Richard Lapointe, vice-président Développement des affaires chez CarbiCrete, l’a bien rappelé : pour faire du ciment Portland, il faut chauffer du calcaire. Si 40 % des émissions de GES du ciment viennent du chauffage, 60 % viennent de la réaction chimique de décarbonatation du calcaire qui rejette donc du CO2. D’où l’idée révolutionnaire de CarbiCrete de produire du béton sans ciment ! Comment ? En remplaçant le ciment par des scories d’acier. De plus, comme les scories durcissent en présence de CO2, le béton de CarbiCrete séquestre aussi le CO2. Au final, un bloc de béton CarbiCrete évite l’émission de 1,5 kg éq. CO2 et séquestre 0,5 kg éq. CO2. Patio Drummond fait affaire avec CarbiCrete pour fabriquer des blocs en béton. La DEP spécifique, couvrant la phase de fabrication, indique que les émissions de GES pour 1 m³ de ces blocs en béton CarbiCrete sont de 11,7 kg éq. CO2, alors que pour des blocs de béton équivalents en ciment Portland, les émissions de GES seraient de l’ordre de 150 à 190 kg éq. CO2, comparait Richard Lapointe.
Une autre déclinaison du produit, un partenariat entre CarbiCrete et Isobloc, a abouti à une première solution de maçonnerie isolée faite de béton décarbonisé en Amérique du Nord : Isobloc ZÉRO. Composé de deux parois de béton massif sans ciment de CarbiCrete et d’un noyau de polystyrène, Isobloc ZÉRO possède une valeur R-25 sans aucun pont thermique. Cette solution conjugue performance thermique, simplicité d’installation et réduction significative des gaz à effet de serre.

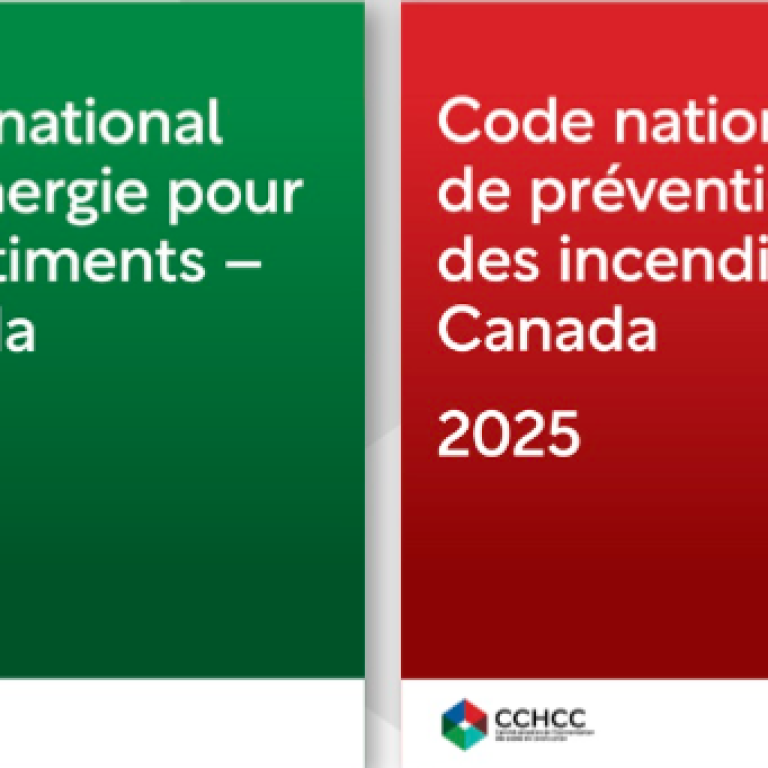

 Poudre de scories d’acier, en remplacement du ciment – Christian Fleury, CarbiCrete
Poudre de scories d’acier, en remplacement du ciment – Christian Fleury, CarbiCrete 
